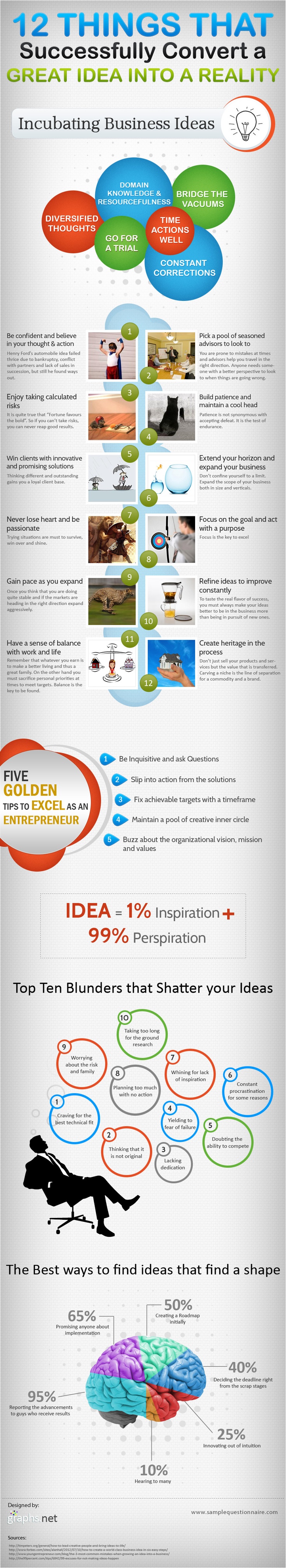Et si le management était un art?
ParisTech Review – Aux sources de l'Ecole de Paris du management, il y a la question de la singularité des pratiques, sur laquelle bute le projet d'un management scientifique. Partons de ce moment où les sciences de gestion entrent en crise. Peut-on le dater ?
Michel Berry – On peut dater, en tout cas, le moment où cette crise est formulée pour la première fois, au tout début des années 1980. Mais pour comprendre ce qui s'est joué alors, il nous faut revenir deux décennies en arrière.
Les sciences du management se sont développées dans les années 1960, autour d'un rêve : être au décideur ce que la balistique est à l'artilleur, une méthode infaillible, permettant de tirer au but à coup sûr.
Jusqu'alors, la gestion était enseignée dans les business schools par des managers, des praticiens qui extrapolaient à partir de leur expérience. Le moment des années 1960 est une rupture : on peut le définir comme une prise de recul, avec la constitution d'un corpus de méthodes et de théories.
On assiste alors dans les universités américaines à l'émergence de véritables départements de management, qui font de la recherche. La discipline se structure. Des sous-disciplines apparaissent, comme autant de territoires balisés par des revues, des processus d'évaluation, de reconnaissance, de cooptation. On passe ainsi en quelques années d'un domaine envisagé et enseigné comme une pratique à une discipline organisée selon le modèle des sciences dures. La littérature spécialisée est un excellent témoin de cette évolution : les chercheurs se focalisent sur des critères formels, tentent de modéliser leur pensée en usant de formules mathématiques, testent leurs hypothèses grâce à des batteries de tableaux statistiques…
C'est à cette époque, notons-le au passage, que se sont développés les indicateurs de gestion qui ont ensuite envahi les entreprises. Certes, depuis l'entre-deux-guerres l'organisation scientifique du travail avait posé les premiers jalons de cette tendance, mais c'est dans les années 1960 que l'idée d'un management scientifique prend toute son extension. S'il fallait citer un nom ici, ce serait celui de Herbert Simon, le président du Département de management industriel à Carnegie Tech, qui reçut le prix Nobel en 1978. Il a beaucoup fait pour développer la discipline et lui donner un cadre rigoureux.
Ce management « scientifique » sort-il rapidement de l'enceinte des universités ?
Oui, il est au cœur de la grande transformation qui anime alors le monde industriel. L'esprit de cette transformation, c'est l'idée d'optimisation et de rationalisation. Ce sont des années de forte croissance économique, et on cultive l'idée de maîtriser rigoureusement cette croissance. Dans les pays européens, l'idée de planification est alors au centre du jeu, et aux Etats-Unis on entreprend de rationaliser les entreprises, les processus de décision, la mesure des résultats : tout devient objet de calcul économique. Le dirigeant, par définition, c'est alors celui qui maîtrise ce calcul.
Les résultats sont d'abord extraordinaires. Les Européens observent avec envie et une pointe d'inquiétude ces succès américains, que certains observateurs associent à un effet d'échelle mais que d'autres, comme en France Jean-Jacques Servan-Schreiber, attribuent à un management gap. Des centaines d'étudiants sont alors envoyés dans les universités américaines, et dans les Grandes Ecoles on commence à s'intéresser de très près aux sciences de gestion.
Cela a marché quelque temps, pour des raisons qu'on peut aujourd'hui comprendre : dans une économie de pénurie, où la grande question est de parvenir à satisfaire la demande, la rigueur et l'optimisation sont des qualités précieuses. Plus subtilement, les managers ont pu pendant un temps arguer du caractère scientifique de leurs décisions, ce qui les a aidés à se faire obéir et a contribué à la bonne marche des organisations. Toute une mythologie s'est alors développée autour de cette idée de méthodes qui devaient triompher non pas seulement par leur qualité intellectuelle, mais parce que c'étaient les méthodes des vainqueurs – de ceux qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale, et qui triomphaient aussi sur le plan économique.
Mais dès les années 1970, en partie sous l'effet des chocs pétroliers et des fluctuations des changes, l'économie américaine ralentit. Les grands conglomérats comme GM ne sont plus perçus comme de magnifiques machines bien huilées, mais comme des géants un peu amorphes, dont les produits ne font plus rêver. Car en face sont apparus des concurrents redoutables, aux méthodes très différentes : les Japonais.
Les Japonais signent l'échec du management scientifique ?
D'une certaine vision scientifique du management, en tout cas. C'est le constat que dresse en 1982 un livre qui a marqué son époque, In Search of Excellence (traduit en français l'année suivante sous le titre Le Prix de l'excellence). Les auteurs, Thomas Peters et Robert Waterman Jr, expliquent le succès des Japonais par l'intelligence de leurs méthodes industrielles, qui composent un cocktail bien différent : « trois grammes de science, un litre de sentiment » ! Ce qui compte, c'est l'homme. L'approche japonaise, à travers différentes formules dont le fameux toyotisme ou encore les démarches qualité mises en œuvre à travers la méthode kaizen, est d'abord pragmatique. Elle ne planifie pas, ne prétend pas tout maîtriser du début à la fin, mais s'appuie sur l'apport des employés, enrôlés dans une logique d'amélioration permanente.
Il y avait, dans l'expérience japonaise, des leçons très profondes. Mais le pli était pris : on en tira surtout des catalogues de recettes… Et si les mathématiques étaient remises en cause, on conserva l'idée qu'il existait des méthodes universelles.
Dès les années 1970 cependant, un certain nombre de chercheurs et de praticiens ont commencé à s'interroger. C'est par exemple à ce moment que le Centre de gestion scientifique de l'École des Mines commence à évoluer. Il avait été fondé dans les années 1960 avec l'idée de trouver les bons modèles, mais dès les années 1970 il s'engage dans une démarche bien différente, de compréhension des mécanismes profonds des organisations. Le Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique, créé en 1972 par Bertrand Collomb et que je dirige à partir de 1975, prend une voie semblable, les deux centres dialoguant de concert. Ils ont fondé les bases d'une recherche clinique, c'est-à-dire menée au plus près des réalités du terrain, contrairement aux travaux des business schools, souvent coupées de la pratique, aussi surprenant que cela paraisse.
… et au début des années 1990 est créée l'École de Paris du management, qui se définit explicitement en réponse à la crise du management scientifique.
Notre intuition était la suivante : si les problèmes sont universels, les réponses sont singulières. Elles diffèrent d'un endroit à un autre, d'un secteur à un autre, mais aussi, comme l'a montré en 1989 Philippe d'Iribarne dans son remarquable ouvrage La Logique de l'honneur, d'un pays à un autre.
Sur le terrain, les bonnes réponses sont singulières, pas toujours reproductibles. Elles demandent une inventivité extraordinaire et souvent méconnue. C'est cette intelligence du singulier que j'ai voulu valoriser en créant l'École de Paris du management, qui n'est pas une institution d'enseignement supérieur, mais bien plutôt un lieu d'échange et de réflexion sur les pratiques, envisagées dans ce qu'elles ont d'unique, de singulier.
Mais le risque existe de rester prisonnier de cette singularité : une expérience, au fond, ne renverrait qu'à elle-même.
C'est un risque, en effet, mais il est assumé, et j'irai plus loin : il est en quelque sorte intégré à la méthode. Une de nos séances récentes était organisée autour du leader de la patrouille de France. On est bien, ici, dans l'extrême singularité. Mais c'est précisément en l'explorant qu'on peut développer des idées nouvelles, qui permettront de mieux comprendre, ici et là, d'autres situations. L'introduction du volume XIX des Annales de l'École de Paris, regroupant tous les travaux de 2012, a pour titre « À la manière de la Patrouille de France », pour avancer qu'elle est peut-être un paradigme de l'entreprise efficace de demain.
L'idée centrale, c'est de raisonner par études de cas, non pas en les analysant de l'extérieur – au risque de rabattre l'inconnu sur du connu – mais au contraire en les faisant raconter par les acteurs. La façon dont la pratique nourrit les décisions me semble, d'une manière générale, occultée. Faire parler les acteurs, leur faire raconter leur histoire, offre la possibilité de sortir de cette impasse.
Tout d'abord ce sont eux qui parlent, et ils ne sont pas des théoriciens : même s'ils utilisent des éléments de langage théorique, ils sont d'abord et avant tout porteurs d'une expérience particulière, d'une histoire vécue de l'intérieur, qui ne se laissera pas aisément réduire à un langage convenu. Et, justement, la forme utilisée, le récit, joue ici un rôle central. Elle permet d'abord de communiquer cette expérience de façon vivante, mais elle permet surtout une mise en forme personnelle, située : le récit, c'est ce qui permet de dire ce qu'on a vécu.
C'est d'une certaine façon le contraire d'un PowerPoint. Car l'antimodèle, de mon point de vue, c'est ce que sont trop souvent poussés à faire les consultants : ils arrivent dans une entreprise et entreprennent de plaquer leur modèle, en ignorant généralement tout de l'histoire de cette entreprise ou, pire, en faisant comme si elle n'avait jamais eu lieu. Or elle a eu lieu, précisément : cette histoire s'est déroulée dans un endroit particulier. Et c'est justement cette histoire qui mérite d'être entendue pour comprendre une organisation construite au fil de temps, à mesure que se présentaient des problèmes auxquels devaient être apportées des solutions, parfois improvisées, parfois élaborées patiemment.
Bien sûr, il est bon d'apporter dans une entreprise un peu d'air frais, de donner idée de ce qui se fait ailleurs, des solutions élaborées à l'extérieur. Mais il me semble que le monde industriel d'aujourd'hui survalorise les solutions extérieures, celles des consultants précisément, et peine à reconnaître les solutions souvent inventives développées à l'intérieur des entreprises. L'Ecole de Paris cherche très précisément à les mettre en lumière. Ce qui est une façon de les mettre à l'honneur.
Raisonner par études de cas est aujourd'hui très répandu dans les écoles.
Oui, et du reste c'est une tradition déjà ancienne. Mais elle fut longtemps marginale, et elle le reste au sein de la recherche académique. C'est l'université de Harvard qui a inventé la méthode des cas, au début du XXe siècle. Le département de management était au départ rattaché à la faculté de droit, et vous savez que dans un régime de common law, on raisonne essentiellement à partir de la jurisprudence et donc des études de cas. Harvard a donc développé et raffiné cette culture de cases studies, qui fait d'elle, aujourd'hui encore, l'université la plus proche des entreprises. Ce qu'on ignore c'est que, pour les chercheurs, s'engager dans cette démarche s'apparente à un suicide professionnel car en faisant des cas vous n'avez généralement pas le temps de rédiger autant de publications que vos concurrents. De deux choses l'une, donc : soit vous êtes titularisé par Harvard (et votre tenure est confirmée dans les six ans), soit vous ne valez plus grand chose sur le marché académique. Car dans les autres universités américaines on fait de la recherche et non des cases studies.
Harvard est donc relativement isolée. Certes, les études de cas sont pratiquées dans les business schools, mais d'une façon beaucoup moins ambitieuse : les cas sont toujours envisagés comme des exemples d'une leçon plus générale. Ce n'est d'ailleurs pas illégitime, entendons-nous bien. Mais on peut aussi, et c'est tout aussi intéressant, s'intéresser à lui dans ce qu'il a d'unique, de singulier.
Cela n'est pas sans conséquences, car cela amène à déplacer le focus. Par exemple, en insistant sur la singularité des situations on est amené à valoriser l'intelligence du manager, à faire la part de l'acteur, du praticien. C'est une autre façon de considérer l'entreprise, bien loin des visions qui réduisent les hommes à des points sur une matrice. Les managers ne sont pas substituables, on ne peut les déplacer comme des pions sur un jeu de dames.
Ensuite, se pose la question de ce que l'on peut apporter à un praticien. À ce titre l'expérience qu'il fait en venant raconter son histoire est très importante, et peut nous mettre sur la piste : ce travail de mise en forme est un moment crucial, et on peut l'aider – notamment dans l'échange qui suit la présentation, mais aussi dans le travail de préparation en amont – à penser, à réfléchir. On peut l'aider à formuler son expérience. En prenant soin, bien sûr, ne pas la formuler à sa place, au crible de ce que l'on sait déjà.
Du reste, un apport théorique peut être bienvenu pour l'aider à mettre en forme son expérience. Les théories peuvent aider, à condition de les utiliser de façon non normative.
La dimension littéraire semble être un des points saillants de votre méthode.
Absolument, et à plusieurs titres. Le récit, je vous le disais, est fondamental. La narration est un moyen de donner à penser, et elle permet de mobiliser l'aspect temporel et tout ce qui s'y rapporte – la durée, les événements, les coups de théâtre, les moments d'accélération, d'attente, de suspens. Un des plus grands livres sur la finance, c'est un roman de Zola : L'Argent. Raconter permet de comprendre bien des choses, y compris pour celui qui raconte.
Le compte rendu qui est fait de chacune des séances est extrêmement travaillé sur le plan littéraire, et certains de ces textes sont devenus des best-sellers, lus par des dizaines de milliers de lecteurs. Nous avons plusieurs rapporteurs, qui sont de véritables auteurs. Ce n'est pas seulement qu'ils écrivent bien, c'est qu'ils s'engagent dans le texte comme le ferait un écrivain : même s'il est évidemment impératif qu'ils soient fidèles au propos original, leurs comptes rendus sont bien autre chose qu'une simple retranscription.
Mais le récit oral et le compte rendu écrit ne sont pas tout. Il y a aussi les échanges, et on s'inscrit ici dans une tradition séculaire, celle des salons philosophiques du XVIIIe siècle et de l'art de la conversation. On aurait tort de prendre cela à la légère : sans même remonter à Platon, une conversation bien menée est un moyen de faire surgir des idées, de faire progresser la compréhension d'une situation. Les dirigeants sont souvent isolés, et ils apprécient les échanges d'expérience. Un dialogue entre praticiens, mais aussi entre des praticiens et des chercheurs, enrichira les uns et les autres. Vous l'aurez compris, ce qui se dessine derrière cette approche, c'est une certaine attention à l'humain. On pourrait parler, à ce titre, d'un projet humaniste.
Par opposition au management scientifique, ne faudrait-il pas alors parler d'une culture du management ?
Si, et c'est probablement ainsi que l'on peut dépasser le piège de la singularité : la formation d'une culture managériale est au centre de notre projet, qui s'articule autour de la mise en commun du singulier.
J'irais d'ailleurs plus loin : le management, ainsi conçu, peut être défini comme un art. Une décision peut être observée, et parfois admirée, comme une œuvre. Une œuvre, c'est à la fois un geste profondément individuel, qui engage un style, et un geste enraciné dans une tradition, dans des références – une culture.
C'est important, les œuvres. Et ça l'est d'autant plus que pour de multiples raisons, l'enseignement du management a aujourd'hui tendance à se standardiser. Au début des années 1990, j'avais pu observer le développement d'une critique générale et radicale des business schools aux Etats-Unis : on leur reprochait de s'être enfermées dans des modèles académiques, d'ignorer la réalité des entreprises. Cette critique les a amenées, dans un premier temps, à rechercher des voies alternatives, en s'intéressant à des expériences comme celle de l'École de Paris. Mais à partir de 1996 l'économie américaine est repartie et la critique des business schools s'est calmée, alors qu'elles n'avaient pas encore beaucoup changé. L'appétence pour des schémas alternatifs a diminué.
Depuis le début des années 2000, le monde entier cherche à copier les business schools américaines les plus prestigieuses. Il en ressort une certaine standardisation, encore renforcée par une obsession des classements qui tend à tuer l'originalité. Un élément de cette standardisation est la place croissante des critères liés à la recherche académique dans ces classements. Cela promeut des profils assez homogènes, loin du terrain, qui se résument dans la figure du chercheur global anglophone publiant dans des revues classées « A ». Fort bien ; mais ils se ressemblent tous, et où sont les pratiques dans tout cela ? L'enseignement du management, qui s'était libéré dans les années 1990 des entraves du « management scientifique », est retombé aujourd'hui dans une sorte de scolastique – un discours quasi théologique, qui formate le langage et les esprits, de plus en plus éloigné de la réalité.
C'est dans ce contexte qu'il me semble pertinent d'envisager le management comme un art. Cela remet la singularité des pratiques et des styles au centre du jeu. Cela remet la réalité au centre du jeu. Cela permet la formation, la transmission, mais aussi la critique. La critique joue en effet un rôle majeur en art, même si les artistes la trouvent injuste : elle les pousse à se dépasser, et elle contribue à une mise en scène, une mise en intrigue de l'art qui captive le public et stimule en retour la création. Cette fonction manque cruellement dans le management. On entend certes souvent des propos critiques sur le management des entreprises, mais ce n'est pas comme en art une critique de connaisseurs qui fait avancer, mais souvent une opposition entre une vision tout en blanc et une vision tout en noir qui ne fait guère avancer. C'est pour cela que nous attachons tant d'importance au débat, à l'École de Paris : c'est notre fonction de critique artistique, l'art en question étant ici le management.
La transmission me semble aussi un problème capital et totalement sous-estimé. L'enseignement n'assure qu'une partie de cet enjeu. On peut enseigner des modèles, ce n'est même pas très difficile. Mais comment transmettre ce qui fait la réelle qualité d'une décision, la réelle qualité d'un manager ? Cela s'apprend bien souvent sur le terrain, au jour le jour. Considérer le management comme un art permet d'aller un peu plus loin, en envisageant d'autres formes d'apprentissage, plus élaborées.
Aujourd'hui, on est pris entre le côté abstrait et standardisé de l'enseignement des modèles – qui au fond n'apprend pas grand chose au futur manager – et à la réalité de l'apprentissage sur le terrain, qui est informel et lacunaire. Il y a place pour une troisième voie.
À quoi pourrait-elle ressembler ?
Reprenons l'image de l'œuvre d'art, qui peut nous livrer quelques pistes. Dans la formation d'un artiste, il y a l'acquisition des bases : le solfège pour les musiciens, cadrer une vue pour un cinéaste… Ces bases peuvent être enseignées. Et bien, de la même façon, on peut enseigner à un futur manager des éléments de comptabilité, de finance, de gestion de production, de marketing…
Mais ces bases, qu'on apprend à l'école, ne sont qu'un préalable. Et c'est là que l'exemple des artistes permet d'avancer. Car leur formation n'est jamais achevée, et elle se poursuit au sortir de l'école sous une autre forme : les artistes, continuellement, se cultivent. Un cinéaste passe son temps dans les cinémathèques, un peintre dans les musées, tout en étant curieux, voraces même, d'œuvres très différentes des leurs. De la même façon les managers gagnent à être cultivés : avoir une idée des théories, bien sûr, mais aussi connaître les œuvres des autres, sans hésiter à s'intéresser à des organisations très différentes des leurs.
Cette culture, envisagée comme une méthode d'apprentissage, me semble essentielle. C'est l'un des enjeux de l'École de Paris, mais c'est aussi de cette manière que l'on pourrait appréhender les différents moments qui, au cours d'une vie, mettent un manager en présence d'expériences différentes – d'œuvres différentes, si l'on file la métaphore. Ces moments, ce sont par exemple les stages, et l'importance d'avoir un bon maître de stage est essentiel car c'est grâce à lui que vous pouvez saisir le sens et l'intérêt de ce que vous observez ; ce seront aussi les moments d'apprentissage qui se présentent au fil d'une carrière, quand elle est bien gérée.
Mais pour un manager, les occasions de se cultiver par l'expérience ne sont pas suffisamment nombreuses, ou plus exactement elles ne sont pas suffisamment variées. D'où l'importance d'une médiation, qui lui donne accès à d'autres expériences ; d'où aussi la nécessaire constitution d'une mémoire. Il y a cette formule bien connue des médecins : L'art est long et la vie est courte. C'est ainsi qu'on devrait envisager ce qu'on appelle aujourd'hui la « carrière » d'un manager : un apprentissage, long et varié, qui permet au fil du temps d'acquérir la culture, le savoir-faire, le coup d'œil auxquels on reconnaît un maître.