La robotique de service est au coin de la rue

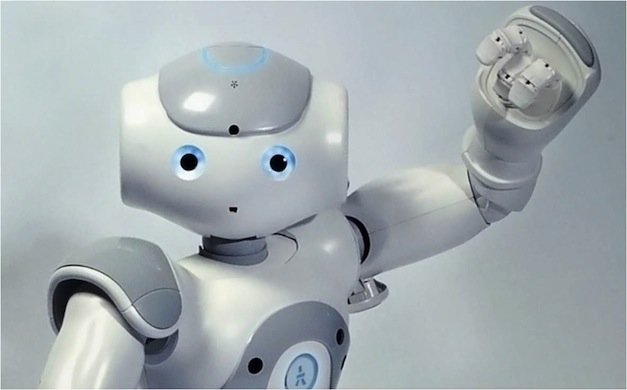

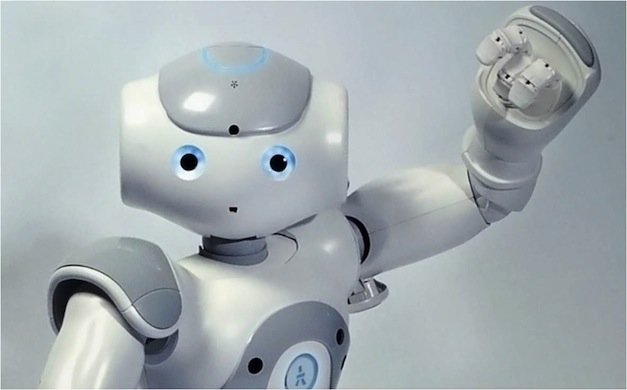
Cet article est le deuxième d'une série dont la publication s'étalera sur plusieurs mois.
Le Cluetrain Manifesto de 1999 s'ouvre sur ces phrases prophétiques : « Les marchés en réseau commencent à s'organiser plus vite que les entreprises qui les ont traditionnellement ciblés. Grâce au web, ces marchés deviennent mieux informés, plus intelligents et plus demandeurs en qualités, qui font défaut à la plupart des entreprises. » Et les auteurs du manifeste embraient avec cette formule devenue fameuse : « Les marchés sont des conversations ».
La dynamique de l'échange, ou les marchés comme conversation
L'intuition de 1999 est devenue la clé de bien des stratégies commerciales, notamment depuis que les réseaux sociaux ont donné aux clients une possibilité inédite de s'exprimer. D'ici quinze ou vingt ans elle pourrait tout simplement être la base de toute relation commerciale bien comprise. Pour vendre un produit ou un service, la conformité technique et la performance seront de plus en plus considérées comme allant de soi. La valeur viendra d'ailleurs.
Deux tendances se dessinent. La première est le développement d'une économie des solutions, dans laquelle les biens seront aussi des services, regroupés en bouquets, offrant aux clients non plus la propriété d'un objet (disons une voiture) mais l'accès à différents usages (autour du transport, de ce que l'on peut faire durant le temps de transport libéré par la conduite automatique). Comme l'écrit Michèle Debonneuil, « les solutions n'ignorent pas les produits industriels, mais elles en organisent l'usage différemment : la production de biens au sens classique du terme se contente de fabriquer et de vendre, au mieux d'assurer un service après-vente. Les solutions sont au contraire centrées sur l'aval, sur l'usage, sur le consommateur. Elles sont fondamentalement centrées sur la personne (human centric). » La performance ou la robustesse d'un bien s'effacent alors devant la qualité des flux dans lesquels il s'inscrit et l' « expérience utilisateur » des usages auxquels il donne accès. Le client devient véritablement un usager, l'entreprise industrielle se mue en fournisseur de services personnalisés.
La deuxième tendance est que le client-usager va émettre, délibérément ou pas, une quantité d'informations que l'entreprise devra capter et interpréter, afin d'évaluer sa satisfaction bien sûr, mais aussi de comprendre ses usages, ses habitudes, ses goûts, et de lui proposer de nouvelles fonctionnalités. Le Big Data, en faisant du client un producteur d'informations, donne un sens nouveau à l'idée du marché comme conversation, qui est aussi un simple – mais riche – échange de données numériques.
Dans la vente aux particuliers, le principal défi consistera à évaluer à chaque instant la disposition d'esprit du client, celle-ci se trouvant quelque part entre la satisfaction fonctionnelle et l'émotion. Regrouper les clients en fonction de leur implication émotionnelle, et le faire en utilisant des outils numériques, sera un des grands marqueurs du succès. Un client satisfait deviendra naturellement, et pour un coût nul, un agent commercial d'une efficacité inégalable. Ce client relais sera souvent un meilleur connaisseur du produit et l'environnement de celui-ci que la plupart des agents commerciaux de l'entreprise.
Le prosommateur deviendra un ambassadeur de la marque. L'internalisation progressive de cette partie prenante qu'est le client, au sein de ce qu'on appelle parfois la « communauté de marque », aura des conséquences sur le modèle d'affaires. Une entreprise capable de se reposer sur ses clients les plus motivés pour vendre ses produits pourra consacrer sa force de vente professionnelle interne à des fonctions commerciales supérieures, en particulier le « cross-selling » (placer des produits connexes auprès des acheteurs ayant déjà consommé) et le « up-selling » (la montée en gamme). Dans cette approche, le client devient un coopérant motivé, compétent et non rémunéré, auquel l'entreprise délègue une fonction importante. Cette délégation comporte des risques qui devront être gérés au plus haut niveau de l'entreprise. L'enjeu, ce sera la stabilité, voire la pérennité, de la marque.
Cet « enrôlement » du client, indissociable de sa montée en puissance, épargnera-t-elle le commerce entre entreprises ? Tout au contraire. Ce qui vaut pour les particuliers vaudra à plus forte raison pour les organisations, et comme le note Jerry Wind (Wharton School) les différences entre BtoB et BtoC tendent aujourd'hui à s'estomper, notamment du fait de l' « empowerment (montée en puissance, montée en capacité) des particuliers, qui bénéficient aujourd'hui d'un niveau d'information souvent comparable à celui des professionnels. Entre BtoC et BtoB, les évolutions seront toutefois sensiblement différentes, tout simplement parce qu'on ne part pas de la même situation de départ.
Même s'il est plus formalisé et apparemment plus rationnel que le commerce BtoC, le BtoB est marqué par une certaine opacité, du fait de la disjonction entre l'acheteur (typiquement, la direction des achats) et l'utilisateur (tel ou tel service de l'entreprise). Mickael Salomon rappelle ainsi que « les décisions d'achat prises par les entreprise impliquent souvent de nombreuses personnes, qui peuvent être chargées de l'achat, influencer directement ou indirectement sur cette décision ou utiliser le produit ou le service ». En dépit ou du fait de cette complexité, les relations commerciales entre une entreprise et ses sous-traitants sont en général plus durables, et les clients ont un pouvoir plus grand face au fournisseur. Les acheteurs sont des professionnels aguerris aux techniques de vente et de marketing opérées par les entreprises vendeuses et, dans une situation de monopole ou d'oligopole, ils savent que le fournisseur est dépendant de ses clients.
Dans le cadre de cette relation asymétrique, une certaine opacité a longtemps été considérée comme nécessaire par des fournisseurs qui n'avaient guère envie de voir leurs marges réduites à zéro. Mais la culture de la transparence est puissante et dans le monde « ouvert » d'Internet l'information circule. De sorte que la communication des informations, et non plus leur rétention, pourrait bien devenir un atout. La transaction commerciale s'accompagnera de flux de données dans les deux sens. Le BtoB est aujourd'hui en retard sur les pratiques de web-marketing développées dans le BtoC, mais l'importance de la « conversation » n'y est pas moins grande, bien au contraire. Le partage des spécifications techniques hier, l'intégration du fournisseur dans les process aujourd'hui, seront complétés demain par une intégration bien plus poussée du feedback utilisateur, rendue possible par le numérique. Le donneur d'ordre, via ses process de fabrication, était entré chez ses fournisseurs. Ceux-ci vont à leur tour s'introduire chez lui, non plus seulement via la figure traditionnelle du représentant, mais via des flux d'informations. Ils collecteront ainsi des masses de données qu'ils ne conserveront pas, mais rendront à leurs clients : c'est dans la qualité de ces échanges que se jouera la relation commerciale.
Métamorphose du commerce
Bousculé par l'ultra client, le paradigme du commerce va poursuivre sa métamorphose. Comme l'explique Cap Gemini dans un rapport en 2013, la nouvelle coalition d'acteurs engagée dans la « vente » construira des produits, puis des services, puis des solutions composites et les entreprises membres de la coalition devront se battre à chaque instant pour justifier leur légitimité et leur valeur ajoutée. Pour défendre sa place face à la concurrence, le vendeur devra se montrer proactif, ne pas se contenter de répondre à la demande. Au lieu d'un produit ou d'un service standard, le client voudra se voir proposer une expérience personnalisée de bout en bout, expérience à la création de laquelle il exigera de participer de manière ouverte et reconnue. L'entreprise, elle, devra offrir cette personnalisation, tout en contenant ses coûts. Pour résoudre ce paradoxe, elle comptera sur la technologie.
Devenue à certains égards un média à la recherche d'une audience, l'entreprise devra s'équiper en conséquence, de manière à pouvoir animer au mieux la nouvelle relation commerciale. Elle devra en particulier recourir à des outils analytiques lui permettant de suivre l'activité de ses clients au sein des différents groupes dont ils sont membres, afin de tenir compte d'une double volonté simultanée du client du futur : être considéré individuellement, en tant que personne, mais aussi socialement, c'est-à-dire comme le membre d'une ou plusieurs communautés. L'entreprise devra investir dans des instruments – certains étroitement liés au Big data – lui permettant d'analyser et d'anticiper les tendances.
Dans un rapport de 2009 sur le « parcours de la décision d'achat », le cabinet de stratégie McKinsey avait insisté sur la délinéarisation du processus. Longtemps, la métaphore de l'entonnoir avait pu rendre compte de l'évolution d'un consommateur confronté à plusieurs marques et poussé par les forces de marketing vers l'une d'elles, de manière irréversible. Au sein de l'entonnoir, guidé par les forces concurrentes du marketing de différentes marques, le consommateurs passait par plusieurs étapes : prise de conscience, familiarité, considération, achat et, enfin, loyauté. Avec Internet et les médias sociaux, qui permettent une conversation interactive entre le consommateur et les marques, cette approche est partiellement caduque car les points de contact entre client et marque sont plus nombreux. L'irréversibilité ne fait plus partie de l'équation. Le consommateur considère au départ plusieurs marques et va procéder à leur « évaluation active » avec les outils numériques et sociaux. Quand il sélectionne une marque au moment de l'achat, le processus n'est pas terminé. Toute l'expérience post achat est cruciale – elle dessine la « boucle de loyauté » – car elle conditionnera les parcours d'achat ultérieurs de ce consommateur.
Garder la main ?
Pour garder la maîtrise de la marque dans le nouvel équilibre commercial, l'entreprise efficace souhaitera influencer les comportements futurs et se connectera à de nombreuses sources d'information pour acquérir une vision holistique (totale) du client, ce que les spécialistes appellent aussi le « VoC » (Voice of the Customer). Cette évolution impliquera parfois des évolutions de l'organisation. Pour que cette vision nouvelle entre dans les usages de manière opérationnelle, il faudra faire travailler ensemble, de manière beaucoup plus étroite, trois catégories de talents : les commerciaux, les techniciens et les experts des données (« data scientists »).
Pour acquérir la connaissance augmentée de l'ultra client, les sources d'information vont se multiplier. Selon Walker, un cabinet américain d'intelligence marketing, les différents canaux numériques utilisés pour échanger avec les clients vont non seulement changer mais leur importance relative va beaucoup évoluer d'ici à 2020. L'ordre actuel place en tête l'e-mail (77 %), devant le téléphone (76 %), le contact en personne (57 %) et le site Web (42 %). En 2020, il sera replacé par un autre quarté où domineront les communautés en ligne (68%), suivies des médias sociaux (63%), des sites Web (61 %) et du courrier électronique (58 %). Le défi sera de fournir à travers tous ces canaux une expérience qui soit globalement cohérente.
Pour Walker, l'arsenal analytique devra comporter au minimum plusieurs outils de « smart data » : l'analyse textuelle, pour scanner les emails des clients et y reconnaître des tendances ; l'analyse descriptive pour mesurer l'état et la stabilité de l'entreprise; l'analyse prédictive pour anticiper les besoins et manques exprimés ou non par les clients ; le profilage et la segmentation de la clientèle pour constituer des groupes cohérents au regard des variables stratégiques de l'entreprise. Seront également nécessaires des instruments capables de relier le retour client aux statistiques financières et opérationnelles de l'entreprise. En soi, ces outils existent depuis longtemps mais leur utilisation en temps réel est une authentique révolution.
Dans le nouvel écosystème, le commerce n'est plus la conséquence logique de la production. C'est plutôt l'inverse : la production devient une des branches de la relation commerciale : l'acte de produire est conçu en fonction de la connaissance des clients. Les entreprises doivent donc reconsidérer le statut de l'activité commerciale et lui conférer le rôle stratégique qui sera le sien. C'est le dirigeant qui doit piloter lui-même cette activité. Il ne peut plus la déléguer à un directeur du marketing. C'est la seule manière d'insuffler l'obsession client-centrique indispensable.
Cisco est généralement considérée comme un pionnier en la matière et mesure la satisfaction client depuis 1997, l'ayant remontée, selon l'indice maison, de 4,06 à 4,45 au fil des années. Une conséquence inattendue de cette montée en gamme de l'intelligence marketing : comme pour tous les actifs stratégiques, il deviendra difficile de mesurer son retour sur investissement en termes strictement financiers. Par exemple, la fluidité des affaires ou une meilleure documentation technique peuvent avoir un impact décisif sur la rétention de clientèle. L'identification des clients à risque sera plus que jamais au centre des préoccupations. La compagnie EMC utilise par exemple les données de « VoC » pour déterminer à quelle fréquence et au moyen de quel instrument adresser des mises à jour logicielles à tel ou tel client.
Une révolution copernicienne de la relation client
Comment fonctionnera alors le service clientèle, devenu tentaculaire, avec des ramifications dans chaque département de l'entreprise ? Il aura la forme d'un hub interactif permettant aux clients d'évoluer sans difficulté entre les différents canaux de distribution. Des agents virtuels sophistiqués recueilleront les informations en provenance du client et les feront circuler au sein de l'organisation, de manière à honorer les demandes, y compris les plus complexes. Le principal défi sera de percevoir les attentes et les émotions du client à travers des interactions essentiellement numériques et les agents du service clientèle – ceux qui animeront la relation numérique – devront posséder une formation sophistiquée et jouir d'une forte autonomie car ils auront dans leurs mains, plus que dans l'ancien paradigme, la réputation de la marque.
Et le client ? Comment arbitrera-t-il ses choix ? Naturellement, le « Big data » ne sera pas à la seule disposition des entreprises. Les clients en seront également de gros consommateurs. Ils voudront choisir comment, quand et par qui être servis. Ils demanderont donc accès aux données des entreprises, avec pour ces dernières à la fois des opportunités de contact et des risques de perte de contrôle. Comme l'explique Doc Searls dans un entretien avec ParisTech Review, de même que les outils de CRM (Customer Relation management) ont offert aux entreprises une connaissance très précise de leurs clients, des outils de VRM (Vendor relation management) vont voir le jour et devenir des instruments usuels de l'acte d'achat.
Le commerce « BtoB » sera impacté spécifiquement avec la fin de ce qu'on appelait depuis les années 1980 la « vente de solutions » (les ancêtres des « solutions » évoquées par Michèle Debonneuil). La méthode consiste à déployer une solution face au besoin identifié chez un client. Dans la pratique, un représentant du fournisseur sélectionnait les clients rencontrant un problème correspondant aux solutions qu'il proposait. Charge ensuite à ce représentant de ferrer son interlocuteur et d'utiliser son entregent pour naviguer au sein de l'entreprise cliente. Une analyse de la Harvard Business Review explique à quel point cette approche est devenue périlleuse pour les fournisseurs qui risquent de se retrouver enfermés dans une simple négociation sur le prix. Les clients ont désormais une excellente compréhension de leur problème et formulent des demandes de propositions (RFP) très précises. Pour exister, le fournisseur doit engager son client très en amont, avant même que celui-ci se formule un besoin. Et penser autrement la relation commerciale : cibler les entreprises agiles en état de flux plutôt que celles qui ont une vision claire de leurs besoins, préférer chez le fournisseur les sceptiques du changement plutôt que les informateurs acquis à sa cause, enfin coacher les agents du changement au lieu de les interroger sur le département achat de leur entreprise. Bref, le fournisseur doit opérer une véritable révolution copernicienne.
Cet article est le premier d'une série dont la publication s'étalera sur plusieurs mois.
Comment caractériser le monde économique de demain ? En se contentant d'extrapoler, on pourrait insister sur trois aspects. Ce sera un monde ouvert, où l'accessibilité croissante des technologies permettra à de nouveaux acteurs d'investir des secteurs jadis protégés ; par conséquent une forme d'instabilité s'imposera. Selon les pays et les secteurs, l'évolution sera très variée dans sa rapidité et dans son intensité. Mais la vague numérique continuera à déferler sur le monde, et avec elle des innovations radicales redéfinissant en profondeur les marchés, les modes de production et le rôle des différentes parties prenantes.
La fin de l'avantage compétitif ?
Certaines de ces innovations se produisent sous nos yeux : nouveaux modèles d'affaires (gratuité et freemium, crowdfunding, innovation sociale, économie de la fonctionnalité), décentralisation de la production avec les makers célébrés par Chris Anderson, révolution des modes de distribution avec l'ogre Amazon et ses compères, bouleversement des règles de la propriété intellectuelle avec l'open source et les hackers… D'autres bouleversements sont à venir, certains déjà en germe, d'autres encore dans les limbes.
Même les secteurs jusqu'ici épargnés par la vague numérique commencent à s'inquiéter. L'industrie du luxe, qui a su protéger son pré carré et dont les grandes marques ont le vent en poupe, pourrait bientôt connaître des ruptures. Le spatial, longtemps monopole de facto de certaines agences publiques, s'ouvre désormais aux acteurs privés. L'automobile a entamé sa métamorphose et les nouveaux entrants comme Tesla mettent les constructeurs sous pression. L'ameublement, le BTP, l'agriculture, l'hôtellerie et la restauration sont déjà confrontés à l'arrivée de nouveaux acteurs, souvent inventifs, parfois voraces. Non que ces activités soient appelées à disparaître. Mais les chaînes de valeur se reconfigurent, faisant une place à de nouveaux venus, qui obligent les anciens à s'adapter, voire à se réinventer. Ce qui est arrivé à l'industrie musicale et à la presse, prises entre l'émergence de la gratuité et la puissance des géants du Net, est à cet égard emblématique.
La seule certitude, c'est l'aventure, au sens étymologique du terme : ad venturus, ce qui va arriver. Quelque chose, quelqu'un va arriver. Il ne s'agit plus seulement d'un concurrent, qui jouerait avec les mêmes armes que vous. Mais d'une disruption, d'un changement des règles du jeu, porté par un acteur radicalement différent – un collectif, un milliardaire aventureux, des hackers, mais aussi un petit entrepreneur ambitieux soutenu par des venture capitalists. L'accélérateur TheFamily, à Paris, a théorisé cette menace avec une formule emblématique : Les barbares attaquent !
L'entreprise du futur risque fort d'évoluer dans un monde où l' « avantage compétitif », fondement du succès depuis la fameuse théorie de Michael Porter, sera devenu une notion largement caduque. Rita Gunther McGrath, professeur à la Columbia Business School, est spécialisée en stratégie des entreprises en environnement volatil. Dans son livre The End of Competitive Advantage, elle explique que dans de nombreux secteurs, la numérisation a fait tomber les barrières à l'entrée et que tout relâchement dans l'innovation peut menacer une entreprise.
Dans ces conditions, la capacité de comprendre son environnement, de s'adapter, voire de se réinventer, sera plus que jamais un atout, conditionnant non pas seulement le développement mais la survie d'une entreprise. Il ne s'agit pas seulement de voir venir l'attaque, mais bien d'y répondre avec la bonne stratégie. Chacun a en tête la chute de Kodak, emportée par l'essor d'une technologie de rupture inventée par l'un de ses ingénieurs, mais que la firme de Rochester a refusé de développer pour ne pas perturber son activité la plus rentable, la pellicule argentique.
Ce qui est arrivé à Kodak est désormais un cas d'école, porteur d'une leçon ambiguë : le succès d'un modèle d'affaires est source de fragilité. À partir de quand, et jusqu'où, faut-il se détourner d'un modèle qui a fait ses preuves ? Cette question ne se posait jusqu'alors que lors de grandes réorientations stratégiques. Elle pourrait devenir permanente dans le futur.
La taille de la firme sera également un facteur important, ainsi que la forme de son actionnariat. On se souvient de la fragilisation des grands conglomérats à la fin des années 1970 et dans les années 1980. Si certains acteurs – pensons aux plateformes numériques comme Google ou Amazon – pourraient tirer parti de leur gigantisme, pour d'autres la taille ou la variété des activités pourrait se révéler un handicap. Comme le soulignait un rapport récent de McKinsey, les grandes firmes s'adapteront moins facilement. Mais les petites peuvent elles aussi être balayées, dès lors que l'un des géants du numérique se sera mis en tête de s'implanter dans leur secteur, comme le raconte Brad Stone dans The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon.
Il y aura, comme toujours et plus que jamais, des perdants. Mais aussi des gagnants. Est-il possible aujourd'hui d'esquisser le portrait robot des entreprises qui auront su se développer dans ce nouvel environnement ? Quelques auteurs y réfléchissent. Leurs travaux, parfois controversés, peuvent nous guider.
La matière et les flux
Jeremy Rifkin évoque dans un livre récent une « troisième révolution industrielle » marquée par la convergence des technologies de la communication et des énergies renouvelables. L'économie industrielle associée à ce nouveau modèle ne serait plus fondée sur la production massive et centralisée de biens en grande série, mais sur une production distribuée, décentralisée, coopérative.
Sans forcément suivre Rifkin dont le propos n'est pas toujours très rigoureux, on peut considérer sérieusement certaines de ses intuitions, qui éclairent une partie des changements en cours. L'entreprise néo-tayloriste dont le modèle émerge dans les années 1970-1980 était fondée sur un certain imaginaire économique et social : l'accumulation individuelle de capital matériel. Elle avait vocation à nous fournir toujours plus d'objets, d'une qualité ou d'une sophistication croissante, pour un prix toujours plus bas. Un exemple achevé de cette stratégie serait le suédois Ikea, mais c'est dans l'automobile, avec les Japonais, qu'il a trouvé ses formules industrielles les plus intéressantes. Or ce modèle trouve aujourd'hui ses limites. Qui nous dit que la possession des objets restera notre idéal de vie ? En réalité, beaucoup de choses ont changé sans forcément que nous nous en rendions compte. La voiture, objet emblématique de la deuxième révolution industrielle, se partage ou se loue. Elle est de moins en moins considérée comme un bien et de plus en plus comme un service. Les biens produits en grande série par Ikea sont de plus en plus éphémères. On les achète, on les utilise, on les jette. L'horizon de la production de masse, aujourd'hui, ce ne sont pas des objets mais des flux, qui passent dans nos vies sans s'y arrêter très longtemps. Les livres électroniques et les films sont le symbole de ces nouveaux usages : nous les achetons, mais pouvons-nous dire que nous les possédons ? On les acquiert, on les consomme, mais ce sont des objets immatériels, stockés à distance. Avec Deezer et Spotify, certaines offres d'Amazon ou encore Netflix, nous ne possédons plus qu'un droit d'accès, certes quasi illimité, mais qu'on ne pourrait plus qualifier de propriété. Les objets connectés, eux, sont bien physiques. Mais ils trouvent leur valeur dans les données immatérielles qui les traversent, dans les systèmes d'information dans lesquels ils sont inscrits.
Les entreprises appelées à produire ces nouveaux biens-services, ces objets-flux, ne pourront plus concevoir leur activité comme les industriels et les fournisseurs de service d'aujourd'hui. Les nouveaux objectifs d'usage définiront de nouveaux modèles d'affaire, de nouvelles chaînes de valeur : les biens et services seront forcément intégrés. Bien rares seront les acteurs capables de tenir toute la chaîne. Les autres seront obligés de s'associer les uns aux autres, non plus verticalement, selon des relations de sous-traitance, mais horizontalement. L'entreprise du XXIe siècle sera fondée sur la coproduction et l'accumulation collective de capital immatériel.
Le modèle Hollywood ou le capital relationnel
Pour passer avec succès d'un modèle à l'autre, il faudra redéfinir en profondeur la notion de performance. Car l'entreprise sera avant tout le membre d'un réseau, une co-entreprise, parfois même une fédération d'entreprises, un ensemble composite regroupé en cluster.
On ne classera plus les entreprises en fonction de leur taille petite, moyenne ou grande, mais en fonction de leurs liens plus ou moins étroits avec des réseaux d'entreprises de tailles éventuellement très différentes, qui s'associent entre elles afin de faire des affaires et créer de la valeur. Le modèle « Hollywood », dans lequel des entreprises se regroupent le temps de réaliser un film puis s'éloignent pour rejoindre un autre projet, permet de comprendre le nouveau paradigme : il s'agit de mutualiser et de coordonner des ressources matérielles, d'accéder à des compétences et des savoir-faire à moindre coût. Abriter le minimum de ressources tout en en garantissant l'accès à toutes : telle serait la recette. Cette évolution a commencé, et le modèle néo-tayloriste développé dans les années 1970-1980 s'efface déjà : dans un modèle collaboratif, il est vain de tout planifier et tout contrôler : l'organisation du travail et le management empruntent davantage au modèle des jeux qu'à l'imaginaire militaire qui les a longtemps imprégnés. Les relations de travail « à vie » n'existent plus et les collaborations ponctuelles se multiplient : les collectifs d'hier ont muté, et le concept même de salariat – qui avait fini par s'imposer au cœur de tout l'édifice du travail dans la société industrielle – devient flou.
Pour le projectiviste Denis Ettighoffer, « l'entreprise contemporaine devient une société relationnelle et doit à ce titre se constituer un capital relationnel. Les méthodes de production d'idées et de création de valeur conjuguée constituant l'économie collaborative n'ont rien à voir avec les méthodes traditionnelles de productivité. Dans l'entreprise en réseau, la logique des fonctions cède la place à une logique de la relation. L'expansion continue des connaissances provoque une rupture dans l'appréhension de la richesse. Ce qui crée de la valeur n'est plus la partie physique du travail mais la composante créatrice et relationnelle de l'activité de chaque opérateur humain. Accéder aux idées et aux connaissances pertinentes devient aussi vital que de disposer de matériaux rares ou même de capitaux car les connaissances permettent de remplacer telle ou telle ressource physique qui ferait défaut ».
Dans cette économie relationnelle, la circulation des savoirs et l'intensification des échanges sont la voie royale de création de valeur. Or ces échanges reposent sur une ouverture méticuleuse et systématique vers l'extérieur de l'entreprise, en se rappelant une loi empirique : 80% des innovations sur les processus viennent de l'intérieur de l'entreprise et 80% des innovations sur les produits et services proviennent des partenaires et des clients. Denis Ettighoffer met les dirigeants en garde : « trop souvent, l'utilisation des réseaux reste cantonnée au développement de la productivité plutôt qu'à l'élaboration de processus d'idéation, clé de la valeur ajoutée conjuguée ». La pollinisation des idées et des savoirs par les réseaux sera à l'avenir aussi importante que les gains de productivité de jadis. Ce sont les talents, l'imagination et la créativité qui priment, car tout le reste est irrémédiablement standardisé.
Dans la même veine, l'Américain Paul Romer, professeur d'économie à Stanford, a développé une théorie de l'économie des idées, sujette à de vives controverses, où les idées sont à l'origine d'une croissance au moins aussi spectaculaire que celle apportée par les gains de productivité obtenus par la systémique informatique. De ses travaux, il ressort que l'économie des idées est structurellement différente de celle des objets. La seconde, physique, finie, débouche sur la pénurie et les rendements décroissants. L'autre tire sa puissance et sa richesse de la possibilité illimitée de partage et d'amélioration incrémentale des idées, avec des rendements croissants. Cette valorisation du patrimoine immatériel, c'est ce que certains appellent l'économie quaternaire.
Organisation : l'essor prévisible de l'intrapreneuriat
Comment les entreprises pourront-elles survivre dans leur forme actuelle, alors que tous les fondements de leur existence sont sapés ? Elles sont déstabilisées par le numérique qui bouscule les frontières, celle qui sépare l'entreprise de son extérieur et celles qui séparent les fonctions au sein de l'entreprise. Aujourd'hui déjà, les usages privés des technologies de l'information s'immiscent progressivement dans l'entreprise, constituent un réseau de connaissance parallèle et mettent sous pression les hiérarchies traditionnelles. Des appareils numériques initialement conçus pour un usage domestique s'adaptent au marché professionnel, les employés construisent peu à peu un « Shadow IT » – une informatique parallèle – où chacun apporte et utilise son outil préféré en contournant la norme.
Enfin, la nouvelle organisation cherche à briser les silos, cherche à favoriser le travail « en mode start-up » et stimule l' « intrapreneuriat », pour pousser le salarié à agir en entrepreneur à l'intérieur même de son entreprise. Autre bouleversement architectural : dans l'entreprise intégrée au sein de l'économie de la connaissance, le pouvoir est entre les mains de ceux qui sont au contact des meilleures sources d'information extérieures à l'entreprise. La hiérarchie fordienne pyramidale, qui repose largement sur la rétention d'information, devient progressivement caduque car elle ralentit le flux des connaissances.
Certains experts avaient prévu de longue date les limites de l'entreprise fordienne classique et l'opportunité que représente le démultiplicateur numérique. John Hagel, un ancien stratège numérique de McKinsey, insistait dès les années 2000 sur la chute inéluctable du rendement des actifs des entreprises : 75% entre 1965 et 2010, malgré de spectaculaires hausses de la productivité. Hagel suggère donc d'éclater les entreprises en entités plus petites. Sur ce morcellement du tissu entrepreneurial, l'économiste Charles Handy avait développé dans les années 1980 le modèle du « trèfle à trois feuilles » pour décrire la silhouette de l'entreprise du futur. La première feuille, c'est le cœur, avec un petit nombre de permanents, très qualifiés et très bien rémunérés pilotant les deux autres feuilles : d'une part le personnel flexible intérimaire à temps partiel et les sous-traitants, y compris les indépendants. Il s'agit en quelque sorte d'une entreprise sans personnel. Cette entreprise noue avec chaque cercle concentrique de partenaires des relations calibrées et on l'a donc parfois baptisée « nœud de contrats ». Dans ce modèle, le statut du travail est infiniment fragmenté.
Tout en prêchant l'adaptation, John Hagel exprimait des doutes sur le bien-fondé d'une intégration profonde des systèmes d'information : intégration entre front office et back office, coopération inter-entreprises, externalisation… Son argument : plus les systèmes sont intégrés, plus le risque d'erreur et son impact sur l'ensemble croissent. En outre dans un contexte de restructuration chronique, l'intégration informatique est un obstacle au changement. Pour John Hagel, qui ne néglige pas les effets délétères de la course en avant technologique, la solution, c'est la modularité, la déstructuration des organisations elles-mêmes en plus petites organisations spécialisées, autonomes, reliées aux autres par les « liens lâches » – en pratique, de simples interfaces standardisées. Voilà pour leur évolution interne.
Quel périmètre stratégique pour l'entreprise étendue ?
L'autre changement, c'est que l'entreprise sort de ses murs. Le fonctionnement en « entreprise étendue » se diffuse parce qu'il reflète bien la nécessité de prendre en compte les parties prenantes à la périphérie de l'entreprise. Le modèle partenarial destiné à favoriser la réalisation de projets est aujourd'hui revendiqué par des grandes entreprises dans leur relation avec leur écosystème de PME sous-traitantes. À l'extérieur, les entreprises seront performantes si elles savent s'entourer d'un écosystème robuste de clients, de fournisseurs et de partenaires, qui leur permet de se concentrer sur leur cœur d'activité.
La question devient alors : comment définir le « périmètre stratégique » d'une entreprise, son « core business » ? Pour John Hagel, les activités stratégiques des entreprises relèvent de trois catégories : développer la relation client, innover dans les produits et services, mettre en place une infrastructure efficiente. Or, ces trois activités ont des objectifs et des contraintes qui ne sont pas toujours compatibles. Schématiquement, si ma priorité est la relation client, alors je veux maximiser le panier de vente moyen et donc proposer une très large gamme de produits, quitte à vendre des produits et services venant de partenaires. En revanche, si ma priorité est de construire une infrastructure efficiente, je dois me spécialiser dans un domaine particulier, afin de rentabiliser des investissements souvent importants, quitte à mettre en place un réseau de vente indirect pour trouver le plus grand nombre de clients intéressés par ma gamme restreinte de produits. Si je décide que mon entreprise sera innovante avant tout, je dois recruter des talents, verser des salaires importants et cultiver l'individualisme, ce qui sera exactement l'inverse des caractéristiques de mes employés si je suis orienté vers l'infrastructure.
Le mouvement perpétuel ?
Ces différents schémas d'activité stratégique pourraient constituer la trame du paysage industriel de demain. Ils ont en commun une attention extrême envers l'environnement extérieur, qui contraste avec les modèles managériaux du XXe siècle, concentrés sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise.
Il faut imaginer – c'est l'un des buts de la série d'articles que nous entamons ici – des dirigeants et des modes de management différents. D'ores et déjà la question se pose : cette attention constante portée à un environnement instable et volatile, est-elle tenable ? Rita Gunther McGrath, dans The End of Competitive Advantage, recommande une sorte de réorganisation perpétuelle comme garantie de la survie. Mais cette perspective a un air de déjà vu. On sait aujourd'hui les défauts de la « révolution permanente » érigée en modèle de management. Les trente dernières années ont vu la difficile mise en mouvement d'organisations qui, pendant des décennies, avaient fait d'une certaine stabilité la clé de leur expansion. Voyant dans cette culture de stabilité une forme de paralysie, certains dirigeants ont cherché à tout prix la « mise en inconfort » de leurs collaborateurs, avec des résultats parfois dramatiques.
Une des difficultés de l'entreprise du futur sera de garder le cap. On le voit avec les grandes figures des géants du net, qui ont avant les autres fait l'expérience d'un environnement hypervolatile. La plupart, de Steve Jobs à Jeff Bezos, sont des figures à mi-chemin entre le génie et le maniaque, ayant en commun d'épuiser leurs collaborateurs et de désorienter leur management. Un Bezos, par exemple, est à la fois fixé sur un objectif stratégique intangible et capable de bouleverser un grand projet en deux minutes. La mobilité permanente permet d'édifier des empires, mais elle n'est pas facile à vivre pour ceux qui y travaillent.
Il est parfaitement possible que les salariés du futur s'accommodent de cette mobilité généralisée, qui correspond aux valeurs et aux habitudes de la fameuse « génération y ». Dans ce cas, les projections de Rita Gunther McGrath pourraient définir un nouveau modèle, socialement accepté et économiquement efficace.
Mais il est possible, aussi, que cet idéal nomade se heurte à l'inertie du monde réel. Faut-il alors imaginer un monde à deux vitesses, avec des entreprises hyper-innovantes et d'autres réduites à la fourniture de biens et services sans grande valeur ajoutée, réduits à de simples commodities ? Ou un vaste mouvement de freinage réglementaire, traduisant l'incapacité des sociétés à accepter cette volatilité générale ? Une seule chose est sûre. Les tendances à l'œuvre sont puissantes, et le mouvement de destruction-création engagé avec la vague numérique vient seulement de commencer. Nous n'avons encore rien vu.